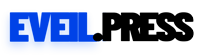Traduction libre
5 mai 2024
Le fascisme est devenu un gros mot aux États-Unis et au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale. Il l’est depuis lors, au point que le contenu du terme a été complètement vidé de sa substance. Il ne s’agit pas d’un système d’économie politique, mais d’une insulte.
Si l’on remonte une décennie avant la guerre, nous trouvons une situation totalement différente. Lisez n’importe quel écrit de la société polie entre 1932 et 1940 environ, et vous trouverez un consensus sur le fait que la liberté et la démocratie, ainsi que le libéralisme du XVIIIe siècle, à la manière des « Lumières », étaient complètement condamnés. Ils devaient être remplacés par une version de ce que l’on appelait la société planifiée, dont le fascisme était l’une des options.
Un livre portant ce nom a été publié en 1937 par la prestigieuse maison d’édition Prentice-Hall, avec des contributions d’universitaires de haut niveau et de personnalités influentes. Il a été salué par tous les médias respectables de l’époque.
Tous les auteurs du livre expliquaient comment l’avenir serait construit par les esprits les plus brillants qui géreraient des économies et des sociétés entières, les meilleurs et les plus brillants ayant les pleins pouvoirs. Tous les logements devraient être fournis par le gouvernement, par exemple, ainsi que la nourriture, mais avec la coopération d’entreprises privées. C’est le consensus qui se dégage du livre. Le fascisme est considéré comme une voie légitime. Même le mot « totalitarisme » est évoqué sans opprobre, mais plutôt avec respect.
Le livre a été oublié, bien sûr.
Vous remarquerez que la section sur l’économie comprend des contributions de Benito Mussolini et de Joseph Staline. Oui, leurs idées et leur pouvoir politique faisaient partie de la conversation dominante. C’est dans cet essai, probablement rédigé par le professeur Giovanni Gentile, ministre de l’Éducation publique, que Mussolini fait cette déclaration concise : « Le fascisme est plus justement appelé corporatisme, car il est la fusion parfaite du pouvoir de l’État et de celui des entreprises ».
Tout cela est devenu plutôt embarrassant après la guerre et a donc été largement oublié. Mais l’affection de nombreux secteurs de la classe dirigeante américaine pour le fascisme était toujours présente. Il a simplement pris de nouveaux noms.
En conséquence, la leçon de la guerre, selon laquelle les États-Unis devaient défendre la liberté par-dessus tout, tout en rejetant totalement le fascisme en tant que système, a été largement enterrée. Et des générations entières ont appris à considérer le fascisme comme un système excentrique et raté du passé, laissant le mot comme une insulte à lancer à tout ce qui est considéré comme réactionnaire ou démodé, ce qui n’a aucun sens.
Il existe une littérature précieuse sur le sujet, qui mérite d’être lue. Un livre particulièrement éclairant est The Vampire Economy de Günter Reimann, un financier allemand qui a relaté les changements spectaculaires des structures industrielles sous le régime nazi. En quelques années, de 1933 à 1939, une nation d’entrepreneurs et de petits commerçants s’est transformée en une machine dominée par les entreprises, qui a éviscéré la classe moyenne et cartellisé l’industrie en préparation à la guerre.
Le livre a été publié en 1939, avant l’invasion de la Pologne et le début de la guerre à l’échelle européenne, et parvient à transmettre la sinistre réalité juste avant que l’enfer ne se déchaîne. À titre personnel, j’ai parlé brièvement à l’auteur (de son vrai nom Hans Steinicke) avant sa mort, afin d’obtenir l’autorisation de poster le livre, et il était étonné que quelqu’un s’y intéresse.
« La corruption dans les pays fascistes découle inévitablement de l’inversion des rôles du capitaliste et de l’État en tant que détenteurs du pouvoir économique », écrit Reimann.
Les nazis n’étaient pas hostiles aux affaires dans leur ensemble, mais s’opposaient uniquement aux petites entreprises traditionnelles, indépendantes et familiales qui ne contribuaient rien aux fins de la construction de la nation et à la planification de la guerre. L’outil essentiel pour y parvenir consistait à faire du parti nazi le régulateur central de toutes les entreprises. Les grandes entreprises avaient les ressources nécessaires pour se conformer aux règles et les moyens de développer de bonnes relations avec les dirigeants politiques, tandis que les petites entreprises sous-capitalisées étaient réduites à néant. Les règles nazies permettaient de faire de la banque à condition de faire passer les choses en premier : le régime avant les clients.
« La plupart des hommes d’affaires dans une économie totalitaire se sentent plus en sécurité s’ils ont un protecteur dans la bureaucratie de l’État ou du Parti », écrit Reimann. « Ils paient pour leur protection comme le faisaient les paysans sans défense à l’époque féodale. Cependant, il est inhérent à la configuration actuelle des forces que le fonctionnaire est souvent suffisamment indépendant pour accepter l’argent, mais ne fournit pas la protection. »
Il écrit sur le « déclin et de la ruine de l’homme d’affaires véritablement indépendant, qui était maître de son entreprise et exerçait ses droits de propriété. Ce type de capitaliste disparaît, mais un autre type prospère. Il s’enrichit grâce à ses liens avec le Parti ; il est lui-même un membre du Parti dévoué au Führer, favorisé par la bureaucratie, solidement établi grâce à ses liens familiaux et à ses affiliations politiques. Dans un certain nombre de cas, la richesse de ces capitalistes du Parti a été créée par l’exercice du pouvoir nu du Parti. Ces capitalistes ont tout intérêt à renforcer le parti qui les a renforcés. D’ailleurs, il arrive parfois qu’ils deviennent si forts qu’ils constituent un danger pour le système et qu’ils soient liquidés ou purgés ».
C’était particulièrement vrai pour les éditeurs et les distributeurs indépendants. Leur faillite progressive a servi à nationaliser efficacement tous les médias survivants qui savaient qu’il était dans leur intérêt de se faire l’écho des priorités du parti nazi.
Reimann a écrit : « Le résultat logique d’un système fasciste est que tous les journaux, services d’information et magazines deviennent des organes plus ou moins directs du parti et de l’État fascistes. Ce sont des institutions gouvernementales sur lesquelles les capitalistes individuels n’ont aucun contrôle et très peu d’influence, sauf s’ils sont des partisans loyaux ou des membres du parti tout-puissant. »
« Sous le fascisme ou tout autre régime totalitaire, un rédacteur en chef ne peut plus agir en toute indépendance », écrit Reimann. « Les opinions sont dangereuses. Il doit être prêt à publier n’importe quelle “nouvelle” émise par les agences de propagande de l’État, même s’il sait qu’elle est en totale contradiction avec les faits, et il doit supprimer les vraies nouvelles qui portent atteinte à la sagesse du dirigeant. Ses éditoriaux ne peuvent différer de ceux d’un autre journal que dans la mesure où il exprime la même idée dans un langage différent. Il n’a pas le choix entre la vérité et le mensonge, car il n’est qu’un fonctionnaire de l’État pour qui la “vérité” et l’“honnêteté” n’existent pas en tant que problème moral, mais sont identiques aux intérêts du Parti ».
Cette politique se caractérisait notamment par un contrôle agressif des prix. Ces contrôles n’ont pas permis d’enrayer l’inflation, mais ils ont été politiquement utiles à d’autres égards. « Dans de telles circonstances, presque chaque homme d’affaires devient nécessairement un criminel potentiel aux yeux du gouvernement », écrit Reimann. « Il n’y a guère de fabricant ou de commerçant qui, intentionnellement ou non, n’ait pas violé l’un des décrets sur les prix. Cela a pour effet d’affaiblir l’autorité de l’État ; d’un autre côté, cela rend les autorités de l’État plus redoutées, car aucun homme d’affaires ne sait quand il risque d’être sévèrement sanctionné ».
À partir de là, Reimann raconte de nombreuses histoires merveilleuses, mais qui font froid dans le dos, comme celle de cet éleveur de porcs qui, confronté à des plafonds de prix sur son produit, les a contournés en vendant un chien à prix élevé avec un porc à bas prix, après quoi le chien lui a été rendu. Ce genre de manœuvre est devenu courant.
Je ne peux que recommander vivement ce livre, qui jette un regard brillant sur le fonctionnement de l’entreprise sous un régime de type fasciste. Dans le cas de l’Allemagne, le fascisme a pris une tournure racialiste et antijuive à des fins de purges politiques. En 1939, il n’était pas tout à fait évident comment cela aboutirait à une extermination massive et ciblée à une échelle gargantuesque. Le système allemand de cette époque présentait de nombreuses similitudes avec le cas italien, qui était un fascisme sans l’ambition d’un nettoyage ethnique complet. Dans ce cas, il est intéressant de l’examiner comme un modèle pour comprendre comment le fascisme peut se révéler dans d’autres contextes.
Le meilleur livre que j’ai vu sur l’affaire italienne est le classique As We Go Marching (1944) de John T. Flynn. Flynn était un journaliste, un historien et un érudit très respecté dans les années 1930, mais il a été largement oublié après la guerre en raison de ses activités politiques. Mais son érudition exceptionnelle résiste à l’épreuve du temps. Son livre déconstruit l’histoire de l’idéologie fasciste en Italie à partir d’un demi-siècle auparavant et explique l’éthique centralisatrice du système, tant en politique qu’en économie.
Après un examen érudit des principaux théoriciens, Flynn en fait une belle synthèse.
Le fascisme, écrit Flynn, est une forme d’organisation sociale :
1. Dans laquelle le gouvernement ne reconnaît aucune limite à ses pouvoirs — le totalitarisme.
2. Dans laquelle ce gouvernement débridé est dirigé par un dictateur — le principe de leadership.
3. Dans laquelle le gouvernement est organisé pour faire fonctionner le système capitaliste et lui permettre de fonctionner dans le cadre d’une immense bureaucratie.
4. Dans laquelle la société économique est organisée sur le modèle syndicaliste, c’est-à-dire par des groupes de production constitués en catégories artisanales et professionnelles sous le contrôle de l’État.
5. Dans laquelle le gouvernement et les organisations syndicalistes dirigent la société capitaliste selon le principe de l’autarcie planifiée.
6. Dans laquelle le gouvernement se considère responsable de fournir à la nation un pouvoir d’achat adéquat par le biais de dépenses publiques et d’emprunts.
7. Dans laquelle le militarisme est utilisé comme un mécanisme conscient des dépenses du gouvernement.
8. Dans laquelle l’impérialisme est inclus en tant que politique découlant inévitablement du militarisme ainsi que d’autres éléments du fascisme.
Chaque point mérite d’être commenté plus longuement, mais concentrons-nous sur le point 5 en particulier, qui porte sur les organisations syndicalistes. À l’époque, il s’agissait de grandes entreprises gérées en mettant l’accent sur l’organisation syndicale de la main-d’œuvre. À notre époque, elles ont été remplacées par une surclasse managériale dans les secteurs de la technologie et de la pharmacie, qui a l’oreille du gouvernement et a développé des liens étroits avec le secteur public, chacun dépendant de l’autre. C’est ici que nous trouvons l’essentiel de ce qui fait que ce système est qualifié de corporatiste.
Dans l’environnement politique polarisé d’aujourd’hui, la gauche continue de s’inquiéter du capitalisme débridé tandis que la droite est toujours à l’affût de l’ennemi du socialisme intégral. Chaque camp a réduit le corporatisme fasciste à un problème historique du même ordre que les bûchers de sorcières, totalement vaincu, mais utile comme référence historique pour former une insulte contemporaine à l’encontre de l’autre camp.
En conséquence, et armés de bêtes noires partisanes qui ne ressemblent en rien à une menace réellement existante, presque tous ceux qui sont politiquement engagés et actifs sont pleinement conscients qu’il n’y a rien de particulièrement nouveau dans ce que l’on appelle la Grande Réinitialisation. C’est un modèle corporatiste — une combinaison du pire du capitalisme et du socialisme sans limites — qui privilégie l’élite aux dépens du plus grand nombre, ce qui explique pourquoi ces travaux historiques de Reimann et Flynn nous semblent si familiers aujourd’hui.
Et pourtant, pour une raison étrange, la réalité tangible du fascisme en pratique — non pas l’insulte, mais le système historique — est à peine connue, que ce soit dans la culture populaire ou académique. Cela rend d’autant plus facile la réimplantation d’un tel système à notre époque.
Jeffrey Tucker est fondateur, auteur et président du Brownstone Institute. Il est également chroniqueur économique principal pour Epoch Times, auteur de 10 livres, dont Life After Lockdown, et de plusieurs milliers d’articles parus dans la presse scientifique et populaire. Il donne de nombreuses conférences sur l’économie, la technologie, la philosophie sociale et la culture.
Texte original : https://brownstone.org/articles/the-machinery-of-fascism-revisited/