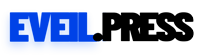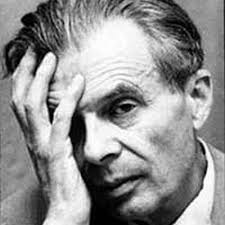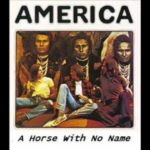Traduit librement d’une conférence donnée par Huxley au temple Védantique en 1960.
Je voudrais commencer cette conférence par la lecture de deux ou trois lignes du vingt-et-unième chapitre du livre de l’Apocalypse. Ce chapitre contient une description de la Nouvelle Jérusalem, et se termine ainsi : « … la place de la ville est d’or pur d’une parfaite transparence. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. ». De la même façon, bien sûr, il n’y avait pas de temple ni de religion, au sens ordinaire du terme, en Éden. Adam et Eve n’avaient pas besoin d’un temple et n’avaient pas besoin du dispositif ordinaire de la religion, car ils étaient en mesure d’entendre la voix du Seigneur lorsqu’ils se promenaient dans le Jardin dans la fraîcheur du jour. Et lorsque nous regardons le livre de la Genèse, nous constatons que la religion, au sens conventionnel du terme, n’a commencé qu’après l’expulsion d’Adam et Ève du Jardin, et que la première trace en est la construction des deux autels par Caïn et Abel ; et, malheureusement, c’est aussi la trace de la première guerre religieuse. Caïn, si vous vous souvenez, était un cultivateur, et un végétarien comme Hitler, et Abel était un gardien de troupeau et un mangeur de viande ; et ils étaient passionnément divisés, évidemment, sur leurs différentes occupations. Cela leur a donné une sorte d’absolutisme religieux, avec le triste résultat que nous connaissons. Puis, dans le quatrième chapitre de la Genèse, nous trouvons la mention d’une nouvelle phase par rapport à la religion. C’est après la naissance de Seth, qui était le troisième fils d’Adam. Il est dit dans le quatrième chapitre : « Seth, lui aussi, eut un fils. Il l’appela du nom d’Hénoch. Alors on commença à invoquer le nom du Seigneur. » C’est évidemment le début de ce que l’on peut appeler le type conceptuel de la religion – le type de côté liturgique d’une part et le côté verbalisé de la religion d’autre part.
Ces deux ensembles de références, au début de la Bible et à la fin, illustrent très clairement un point important : il existe deux grands types de religion. Il y a la religion de l’expérience immédiate (la religion, selon les mots de la Genèse, d’entendre la voix de Dieu en se promenant dans le Jardin dans la fraîcheur du soir – la religion de la connaissance directe du Divin dans le monde), et il y a la religion des symboles (la religion de l’imposition de l’ordre et du sens au monde par des symboles verbaux ou non verbaux et leur manipulation – la religion de la connaissance au sujet du Divin plutôt que de la connaissance directe du Divin). Et ces deux types de religion ont, bien sûr, toujours existé, et nous devons les discuter tous les deux.
Commençons par la religion comme manipulation de symboles, comme imposition d’un ordre et d’un sens au flux de l’expérience. En pratique, nous constatons qu’il existe deux types de religions manipulant des symboles. Il y a la religion du mythe, et il y a la religion de la croyance et de la théologie. Le mythe est évidemment une sorte de philosophie non logique. Il exprime (soit par des mots, soit sous la forme d’une histoire, très souvent sous la forme d’une image visible, soit même sous la forme de mouvements corporels – sous la forme d’une danse ou d’un rituel compliqué) un sentiment généralisé sur la nature du monde et de l’expérience de l’homme à son égard. Et le mythe est une chose sans prétention, en ce sens qu’il ne prétend pas être strictement vrai ; il est simplement l’expression de nos sentiments sur l’expérience. Et même si c’est une philosophie non logique, c’est très souvent une philosophie très profonde, précisément parce qu’elle est non logique et non discursive ; parce qu’elle permet dans le récit, ou dans l’image, le tableau, la statue, ou dans la danse, de rassembler en un seul ensemble expressif plusieurs des parties disparates et même apparemment incommensurables et incompatibles de notre expérience. Il les réunit et les montre d’un seul coup d’œil comme un tout indissoluble, exactement comme nous les vivons. En ce sens, c’est le type de symbolisme le plus profond. Permettez-moi de prendre un seul exemple : le mythe de la Grande Mère, qui traverse toutes les religions antérieures. (Il est encore très puissant dans la religion de l’hindouisme.) Ce mythe dans presque toutes ces religions montre la Mère comme étant simultanément le principe de vie, de fécondité, de fertilité, de bonté, de compassion nourrissante ; mais en même temps comme étant le principe de mort et de destruction. Dans l’hindouisme, Kali est à la fois la Mère infiniment gentille et aimante et la terrifiante Déesse de la destruction, qui possède un collier de crânes et qui boit le sang des êtres humains à partir d’un crâne. Et bien sûr, ce tableau est profondément réaliste, car, évidemment, si vous donnez la vie, vous devez nécessairement donner la mort – car la vie se termine toujours par la mort et exige d’être renouvelée par la mort. Nous voyons donc ici, je pense, un très bon exemple de cette philosophie profonde, non logique, qui peut être exprimée sous forme mythologique. Et quand on demande si les mythes sont vrais ou non, c’est une question sans importance, ils ne sont tout simplement pas vrais. Comme je l’ai déjà dit, ils sont simplement l’expression de nos réactions au mystère du monde dans lequel nous vivons.
Je pense qu’il est utile de mentionner ici que, dans la pratique, nous trouvons ces anciennes religions non logiques, mythiques, très fréquemment associées à ce que l’on a appelé des exercices spirituels, mais qui sont en fait des exercices psychophysiques. Nous constatons très souvent que ces religions font un grand usage du corps dans leur approche religieuse du monde. Nous les trouvons utilisant le chant, la danse et le geste, et en tirer une véritable sorte de révélation. C’est comme si le relâchement des tensions physiques, que nous accumulons par notre vie anxieuse et égocentrique, par ces gestes physiques constituait ce que les Quakers appelaient une « ouverture » par laquelle les forces profondes de la vie qui sont en nous et à l’extérieur peuvent circuler plus librement. Et il est très intéressant de voir, même au sein de notre propre tradition, comment ce lâcher-prise occasionnel et cette organisation du corps à des fins religieuses ont eu des influences profondes et très salutaires.
Par exemple, pourquoi les Quakers ont-ils été appelés « Quakers » ? Pour la simple raison qu’ils ont tremblé. Les premiers quakers étaient réputés pour cela, que leurs réunions se terminaient très souvent par des mouvements corporels violents des plus étranges, qui étaient profondément libérateurs et qui permettaient, pour ainsi dire, au flot de l’Esprit de se déverser en eux. Et, d’un point de vue historique, les quakers, tant qu’ils tremblaient, avaient le plus grand degré d’inspiration et étaient au sommet de leur puissance spirituelle. Nous avons le même phénomène chez les Shakers ; les Shakers s’agitaient tout comme les quakers tremblaient. Et nous voyons dans le mouvement religieux contemporain appelé Subud exactement le même phénomène, la venue sur les personnes assemblées de ces mouvements physiques furieusement violents et involontaires qui produisent ce genre de libération et permettent à beaucoup de gens (je ne sais pas s’ils le font pour tous) l’afflux et le passage de forces spirituelles profondément puissantes. Et je voudrais ici citer les propos d’un éminent spécialiste français de l’islam qui dit : « L’Europe moderne (bien sûr, l’Europe moderne inclut l’Amérique moderne) est presque la seule à avoir renoncé, par respectabilité bourgeoise et puritanisme gallican, à la participation du corps dans la poursuite de l’Esprit. En Inde, comme dans l’Islam, les chants, les rythmes et la danse sont des exercices spirituels ». Je pense que c’est une remarque profondément vraie et importante, et il est intéressant de voir comment ces coins plutôt isolés de notre propre tradition – la façon dont cette exploitation du corps aux besoins de l’Esprit, cette permission d’utiliser le corps pour laisser l’Esprit plus libre – ont illustré le fait qui est si manifestement clair lorsque nous étudions l’histoire des religions orientales.
Nous devons maintenant considérer le problème de la religion comme l’autre type de système de symboles, non pas comme le système des mythes, mais comme le système des concepts, des croyances, des dogmes, des convictions. Il s’agit d’un type de symbolisme profondément différent, et c’est celui qui, en Occident, a été le plus important. Les deux types de religion – la religion de l’expérience immédiate, de la connaissance directe du Divin, et ce deuxième type de religion symbolique – ont, bien sûr, coexisté en Occident. Les mystiques ont toujours formé une minorité au milieu des religions officielles manipulatrices de symboles, et cela a été une symbiose, mais une symbiose plutôt difficile. Les membres de la religion officielle ont eu tendance à considérer les mystiques comme des gens difficiles et perturbateurs. Ils ont même fait des jeux de mots sur le nom ; ils ont appelé le mysticisme « schisme brumeux (misty schism) », dans le sens où ce n’est pas une doctrine claire. C’est une doctrine nébuleuse, c’est une doctrine antinomique, et qui ne se conforme pas facilement à l’autorité ; et ils l’ont détestée en conséquence. Et de leur côté, bien sûr, les mystiques ont parlé – pas exactement avec mépris, parce qu’ils ne ressentent pas de mépris, mais avec tristesse et compassion à l’égard de ceux qui sont dévoués à la religion symbolique, parce qu’ils estiment que la poursuite et la manipulation des symboles sont tout simplement incapables, par nature, d’atteindre ce qu’ils considèrent comme la fin suprême : l’union avec Dieu, l’identification avec le Divin. William Blake, qui était essentiellement un mystique, et qui était capable de s’exprimer en termes plutôt violents sur ceux avec lesquels il était en désaccord, parle en ces termes de la relation entre les deux types de religion. Il a ce petit couplet où il dit : « Viens ici, mon garçon ! Dis-moi ce que tu vois là ». Et le garçon répond : « Un fou, empêtré dans un piège religieux ».
Dans la tradition du christianisme occidental, les mystiques ont été assurés d’une position tolérée par la perpétration, à un stade précoce du développement chrétien, de ce que l’on appelle « une fraude pieuse ». Vers le VIe siècle est apparue, une série de volumes néoplatoniciens chrétiens sous le nom de Denis l’Aréopagite, qui fut le premier disciple de Saint Paul à Athènes. Et ces volumes étaient considérés comme ayant presque le rang apostolique. En fait, les livres ont été écrits à la fin du Ve ou au début du VIe siècle en Syrie, et l’auteur inconnu a simplement signé le nom de Dionysos l’Aréopagite sur ses livres afin de leur donner une meilleure audience parmi ses compagnons. C’était un néoplatonicien qui avait adopté le christianisme et qui combinait les doctrines de la philosophie néoplatonicienne et la pratique de l’extase avec la doctrine chrétienne.
La fraude pieuse a connu un grand succès. Bien sûr, les livres de Dionysius ont été traduits en latin au IXe siècle par le premier philosophe Scotus Erigena ; ils sont entrés dans la tradition de l’église occidentale et ont servi par la suite de rempart et de garantie pour la minorité mystique au sein de l’église. Ce n’est que très récemment que la fraude pieuse a été reconnue pour ce qu’elle était. Mais entre-temps, il est intéressant de noter que ce curieux faux a joué un rôle très important, très bénéfique, dans la tradition chrétienne occidentale.
Nous devons maintenant considérer la relation entre les deux types de religion, la religion de l’expérience immédiate et la religion concernée, principalement, par les symboles. Dans ce contexte, l’abbé John Chapman, un bénédictin et un des grands directeurs spirituels du XXe siècle, en a fait des remarques très éclairantes. Il est mort, je suppose, il y a environ vingt-cinq ou trente ans. Ses lettres spirituelles sont d’un très grand intérêt, et il était manifestement lui-même un homme doté d’une profonde expérience mystique. Il était capable d’aider les autres sur le même chemin. Mais dans une de ces lettres, il fait remarquer la grande difficulté de réconcilier, et pas seulement d’unir, le mysticisme et le christianisme : « Saint Jean de la Croix est comme une éponge pleine de christianisme. Si vous pressez tout cela, la théorie mystique complète demeure. Par conséquent, pendant une quinzaine d’années, j’ai détesté Saint Jean de la Croix, et je l’ai traité de bouddhiste. J’aimais Sainte Thérèse et je la lisais sans arrêt. Elle est d’abord chrétienne, puis mystique. Puis j’ai découvert que j’avais perdu quinze ans, en ce qui concerne la prière ». Et maintenant, rapidement, disons ce qu’il entendait par le mot « prière » dans ce contexte. Il ne voulait pas dire, bien sûr, la prière de requête. Il parlait de ce que l’on appelle la « prière de silence », la prière qui consiste à attendre le Seigneur dans un état de passivité alerte et à permettre aux éléments les plus profonds de l’esprit de remonter à la surface.
Dionysius, dans sa Théologie mystique et dans ses autres livres, avait constamment insisté sur le fait que pour connaître Dieu, pour connaître directement Dieu plutôt que de savoir sur Dieu, il faut aller au-delà des symboles et des concepts. Ce sont là, selon lui, de véritables obstacles à l’expérience immédiate du Divin. Et empiriquement, cela est vrai pour tous les maîtres spirituels, tant en Occident qu’en Orient.
La religion de l’expérience directe du Divin est généralement considérée comme le privilège de quelques personnes. Personnellement, je ne pense pas que cela soit nécessairement vrai. Je pense que pratiquement tout le monde est capable de cette expérience immédiate, à condition de s’y prendre de la bonne manière et d’être prêt à faire le nécessaire. Mais, en fait, on a considéré comme allant de soi que les mystiques représentent une très petite minorité parmi une immense majorité qui doit se contenter de la religion des croyances et des symboles, des livres sacrés, des liturgies et des organisations et, bien sûr, des croyances. C’est la foi sous forme de croyance. Or, la croyance est une question de très grande importance. Ces dernières années, un de ces grands best-sellers a été publié, qui s’appelle The Power of Belief (Le pouvoir de la foi); et c’est un très bon titre, car la foi est une très grande source de pouvoir. Elle a un pouvoir sur le croyant lui-même et lui permet d’exercer un pouvoir sur les autres. D’une certaine manière, elle déplace des montagnes. Mais cette croyance, comme toute autre source de pouvoir, est en soi éthiquement neutre ; elle peut être utilisée aussi bien pour le mal que pour le bien. Nous avons à notre époque ce très beau spectacle d’Hitler qui a presque conquis le monde entier grâce au pouvoir de la croyance en quelque chose qui était non seulement manifestement faux mais aussi profondément mauvais. Nous voyons alors que ce fait énorme de croyance, qui est si constamment cultivé au sein des religions manipulatrices de symboles, est essentiellement ambivalent : il peut être à la fois bon et mauvais. Et la conséquence est que la religion en tant que système de croyances a toujours été, au cours de l’histoire, une force ambivalente qui a donné naissance simultanément aux Sœurs de la Charité et à ce que les poètes médiévaux appelaient le Fier Prélat, le tyran ecclésiastique. Elle donne naissance à la forme la plus élevée de l’art et aussi à la forme la plus basse de la superstition. Elle allume les feux de la charité et allume aussi les feux de l’Inquisition – elle allume le feu qui brûle Servetus à l’époque de Calvin. Elle donne naissance à un Saint-François ou à une Elizabeth Fry, mais aussi à un Torquemada. Il donne naissance à un George Fox et donne également naissance à l’Archevêque Laud. Nous voyons donc que cette force formidable a toujours été ambivalente, précisément à cause de l’étrange nature de la croyance et de l’étrange capacité de l’homme, lorsqu’il se lance dans ses spéculations philosophiques, d’apporter des réponses extrêmement étranges et fantastiques.
Les mythes, dans l’ensemble, ont été beaucoup moins dangereux que les systèmes théologiques, précisément parce qu’ils sont moins précis et ont moins de prétentions à être la vérité absolue. Où vous avez un système théologique, il y a la prétention que ces propositions sur les événements du passé et du futur et sur la structure de l’univers sont absolument vraies. Par conséquent, une réticence à accepter ces propositions est considérée comme une rébellion contre Dieu, digne du châtiment le plus éternel. Et nous voyons que ces systèmes ont, d’un point de vue historique, été utilisés comme justification de presque tous les actes d’agression et d’impérialisme et de l’expansion impérialiste dans le passé. Il n’y a pas un seul crime de grande envergure dans l’histoire qui n’ait été commis au nom de Dieu. Et c’est une chose terriblement douloureuse et troublante, je pense, lorsqu’on étudie l’histoire des religions, de voir avec quelle facilité cette énorme force peut être utilisée à des fins les plus indésirables. Cela a bien sûr été résumé il y a plusieurs siècles dans l’hexamètre de Lucrèce, où il dit : « Tantum religio potuit suadere malorum » (« De si grands maux que cette religion est capable de persuader les hommes de commettre »). Mais il aurait également dû ajouter : « Tantum religio potuit suadere bonorum » (« Un si grand bien que cette religion est capable de persuader les hommes de commettre »). Néanmoins, il est clair que le bien a dû être payé par beaucoup de mal.
Ce genre de qualité de la religion en tant que système de symboles théologiques, source de conflits et de controverses, a non seulement provoqué les djihads et les croisades d’une religion contre une autre, mais a également produit une énorme quantité de frictions internes au sein de la même religion. L’odium theologicum, la haine théologique, est connue pour sa virulence. Les guerres de religion des XVIe et XVIIe siècles ont eu un degré de férocité qui dépasse vraiment toute croyance. Elles ont été incroyablement horribles – la guerre de Trente Ans, par exemple. Et dans ce contexte, je pense que nous devrions nous rappeler ce que le professeur Hofstadter a dit dans sa conférence, à savoir que « Nous avons maintenant l’habitude de dire : “Oh, quels grands maux le naturalisme en tant que philosophie a apportés au monde”. Mais d’un point de vue historique, le surnaturalisme a engendré des maux tout aussi graves, et peut-être même encore plus graves dans le passé ». Nous ne devons donc pas nous laisser emporter par ce genre de rhétorique.
J’ai déjà mentionné cette extraordinaire capacité des philosophes et des théologiens à produire des idées fantastiques qu’ils honorent ensuite par le nom de dogme ou de révélation. Et à titre d’exemple, je voudrais citer quelques faits concernant l’histoire de l’une des idées fondamentales du christianisme, l’idée d’expiation. Les informations que j’ai ici sont basées sur l’excellent essai de l’Encyclopédie de religion et d’éthique de Hastings. Cet essai est du Dr. W. Adams Brown, qui a été à un moment donné professeur de théologie à l’Union Seminary de New York. Il a exposé l’histoire de cette doctrine de manière très lucide et l’a résumée, à la fin, de manière très convaincante. Permettez-moi de passer rapidement en revue cette histoire, car elle illustre, je pense, très clairement les dangers de ce type de religion manipulateur des symboles.
Dans la première période du christianisme, la mort du Christ était considérée soit comme un sacrifice d’alliance, comparable au sacrifice de l’agneau pascal dans la religion juive (il existe une certaine autorité évangélique à ce sujet), soit comme une rançon, comparable au prix payé par un esclave pour sa liberté ou au prix payé par un prisonnier de guerre pour être libéré. Ces deux idées sont évoquées dans les évangiles. Plus tard, est venue l’idée que la mort du Christ était l’expiation sanglante du péché originel. Ceci était basée sur une idée très ancienne selon laquelle tout méfait nécessitait l’expiation par la souffrance du pécheur lui-même ou d’un substitut au pécheur. Par exemple, dans l’Ancien Testament, nous lisons que David a péché en faisant le recensement de son peuple, et qu’il a été puni par une peste qui a tué soixante-dix mille de ses sujets, mais n’a pas tué David. L’expiation a été faite par substitut, et cette idée a été reprise dans la théologie postérieure à l’évangile.
À l’époque patristique, nous constatons une profonde différence entre les théologiens grecs et les théologiens latins. Les théologiens grecs ne s’intéressaient pas principalement à la mort du Christ, ils s’intéressaient à la vie. La mort était considérée comme un simple incident dans la vie. Leur vision de l’expiation était qu’elle existait, non pas pour sauver l’homme de la culpabilité, mais pour le sauver de la corruption dans laquelle il était tombé après la chute d’Adam et Eve. Et la conséquence était que la vie était donc plus importante que la mort. Irénée dit que le Christ est venu et a vécu la vie de l’homme afin que l’homme puisse vivre une vie comparable à celle du Christ, et que c’était la qualité salvatrice de l’expiation. Chez les pères latins, l’accent était tout à fait différent. Là, l’idée était que l’homme était racheté, non pas de la corruption en premier lieu, mais de la culpabilité. Il était racheté de la punition qui devait lui être infligée pour le péché d’Adam. Alors que les théologiens grecs considéraient, essentiellement, Dieu comme une Réalité absolue, un Esprit absolu, les théologiens latins le considéraient dans l’esprit du guerrier romain, comme un gouverneur et un législateur, et par conséquent leur théologie tend à s’exprimer en termes légalistes.
Actuellement, la doctrine s’est développée lentement. St. Augustin insiste continuellement sur la culpabilité du péché originel et sur le fait que cette culpabilité est entièrement héritée par tous les membres de la race humaine, de sorte qu’un enfant non baptisé doit nécessairement aller directement en enfer. Il a un très beau passage où il dit que le sol de l’enfer est pavé de bébés de moins d’un pas. Ce point de vue a été développé au fil des siècles. Et puis il y a eu une longue période de discussion sur la question de la rançon : à qui était versée la rançon de la mort du Christ ? De nombreux théologiens ont insisté sur le fait que la rançon était payée à Satan, que Dieu avait livré le monde à Satan avec le souhait de le reprendre, et qu’il devait donc payer ce prix énorme à Satan pour le privilège de le reprendre – reprendre l’homme de l’emprise de Satan. D’autre part, certains théologiens ont insisté sur le fait que la rançon était payée à Dieu, pour satisfaire l’honneur de Dieu – que Dieu avait été infiniment offensé, et que la seule réparation d’une offense infinie était une satisfaction infinie ; et que par conséquent, la seule satisfaction possible était donc la mort de l’homme-Dieu, du Christ. C’est ce dernier point de vue qui a prévalu dans la doctrine plus ou moins officielle formulée par saint Anselme au XIIe siècle – à savoir que la réparation était payée pour la satisfaction de l’honneur de Dieu. Et nous pouvons remarquer, incidemment, qu’Anselme parlait du « sur-plus » de la satisfaction. Cette infinie Personne tuée constituait une sorte de fonds de mérite qui pouvait être utilisé pour l’absolution des péchés, et c’est sur la base de cette doctrine que l’église médiévale a élargi sa pratique de vente d’indulgences, ce qui a conduit, le moment venu, à la Réforme. On voit donc à nouveau les curieuses conséquences de ces différentes doctrines.
Puis nous arrivons à la Réforme, et nous constatons que Calvin estimait que la justice punitive était une partie essentielle du caractère de Dieu, et que le Christ portait en fait le châtiment qui était dû à l’homme – que tout péché devait être puni, et que le Christ (et ce sont les mots qu’il a utilisés) « portait le poids de la colère divine, était frappé et affligé, et éprouvait tous les signes d’un Dieu en colère et vengeur ». Ces points de vue ont été modifiés par les Arméniens, les Sociniens et Hugo Grotius aux XVIe et XVIIe siècles, et ont progressivement fait place à des points de vue plus éthiques et spirituels au sein du protestantisme moderne.
Je voudrais maintenant lire ce passage dans lequel le professeur Adams Brown résume toute cette étrange histoire. Il dit : « Le caractère expiatoire de la mort du Christ se trouve maintenant dans sa qualité pénale de souffrance, maintenant dans son caractère éthique d’obéissance. Il est représenté maintenant comme une rançon pour racheter les hommes de Satan, maintenant comme une satisfaction due à l’honneur de Dieu, maintenant comme une peine exigée par sa justice. Sa nécessité est désormais ancrée dans la nature des choses et, là encore, elle s’explique comme le résultat d’un arrangement dû au simple bon plaisir de Dieu ou répondant à son sens de l’aptitude. Les moyens par lesquels ses bienfaits sont transmis aux hommes sont parfois conçus mystiquement, comme dans la théologie grecque du Sacrement, parfois légalement, comme dans la formule protestante d’imputation, et, encore une fois, moralement et spirituellement, comme dans les théories plus personnelles du protestantisme récent. En examinant des différences aussi extrêmes, on pourrait être tenté de se demander, avec certains critiques récents, si, en effet, nous avons affaire, ici, à un élément essentiel de la doctrine chrétienne, ou simplement à une survivance d’idées primitives dont la présence dans le système chrétien constitue une perplexité plutôt qu’une aide à la foi… » « Pourtant », ajoute le professeur Brown, « les différences dont nous avons discuté ne sont pas plus grandes que celles qui peuvent être parallèles dans le cas de toute autre doctrine chrétienne ». Et les raisons de ces différences dans des doctrines particulières doivent être recherchées dans les différences fondamentales dans les conceptions de l’homme, de Dieu et de ses relations avec le monde. Là où Dieu est considéré comme l’Esprit absolu, l’expiation est conçue comme les théologiens grecs l’ont conçue. Là où, dans la théologie du catholicisme romain et du protestantisme antérieur, Dieu est conçu principalement comme gouverneur et juge, la phraséologie juridique semble être l’expression naturelle de la foi religieuse. Là où les doctrines éthiques sont mises en avant, comme dans les conceptions modernes de l’expiation, une sorte de langage éthique et spirituel est utilisé.
Cela montre très clairement, je pense, les difficultés extraordinaires auxquelles nous sommes confrontés lorsque nous nous lançons dans une théologisation systématique de l’expérience, un transfert de l’expérience en termes conceptuels et symboliques. Cela conduit évidemment à des difficultés d’une nature des plus extraordinaires, et les avantages qui découlent certainement des expressions théologiques actuelles me semblent certainement compensés par de très graves inconvénients que l’histoire de la religion organisée indique clairement.
Maintenant, regardons ce qu’était, au cours de l’histoire également, l’attitude des partisans de la religion en tant qu’expérience immédiate à l’égard de la religion exprimée en termes de symboles. Sous une forme extrême, Meister Eckhart exprime cette attitude. Il dit : « Pourquoi priez-vous Dieu ? Tout ce que vous dites sur Dieu est faux ». Nous devons ici faire une courte digression sur l’utilisation du mot « vérité » dans la littérature religieuse. Le mot « vérité » est utilisé dans au moins trois sens courants. Il est utilisé comme synonyme de Réalité ; nous disons « Dieu est la Vérité », ce qui signifie que Dieu est le fait primordial. Il est utilisé dans le sens de l’expérience immédiate où, dans le quatrième évangile, il est dit que Dieu doit être adoré en Esprit et en vérité, ce qui signifie une appréhension immédiate de la Réalité divine ; et enfin il est utilisé dans le sens commun du mot comme correspondance entre les propositions symboliques et les faits auxquels elles se réfèrent. Eckhart était, bien sûr, un théologien aussi bien qu’un mystique, et il n’aurait pas nié que la vérité selon le troisième sens était dans une certaine mesure possible en théologie ; il aurait dit que certaines propositions théologiques étaient certainement plus vraies que d’autres. Mais il aurait nié qu’il était possible que la finalité de l’homme, l’union avec Dieu, soit atteinte par la manipulation de ces symboles. Et cette insistance sur l’inefficacité de la religion symbolique pour cette fin ultime d’union avec Dieu a été également soulignée par toutes les religions orientales. Nous la retrouvons dans la littérature de l’hindouisme, du bouddhisme mahayana, du zen, du taoïsme, etc. et je voudrais lire une ou deux des déclarations faites par les mystiques orientaux. En voici une de la Sutralamkara : « La vérité, en effet, n’a jamais été prêchée par le Bouddha, car on doit la réaliser en soi-même. » Et encore : « Ce qui est connu comme l’enseignement du Bouddha n’est pas l’enseignement du Bouddha ». Encore une fois, cela doit être une expérience intérieure. Il y avait même des maîtres zen qui prescrivaient que quiconque utilisait le mot « Bouddha » devait se faire laver la bouche avec du savon, parce que c’était si éloigné du but d’expérience immédiate qui était proposé dans cette branche du bouddhisme. Il y a encore une autre phrase paradoxale : « Quel est l’enseignement ultime du bouddhisme ? Vous ne le comprendrez pas tant que vous ne l’aurez pas ». En attendant, dit Yoka Daishi, ne soyez pas si ignorant et puéril pour confondre le doigt pointé avec la lune que vous indiquez. L’habitude d’imaginer que le doigt pointé est la lune condamne à un échec total tous les efforts visant à réaliser l’unité avec la Réalité.
Telle a été l’attitude habituelle des mystiques de tous les temps, et surtout en Orient. La philosophie orientale a toujours été ce que je pourrais appeler une sorte d’« opérationnalisme transcendantal ». Cela commence par quelqu’un qui fait quelque chose au sujet du Soi, et ensuite, à partir de l’expérience obtenue, on spécule et on théorise sur la signification de cette expérience ; alors que trop souvent – surtout dans la pensée occidentale moderne – on obtient une philosophie qui est une pure spéculation, basée sur des connaissances théoriques et qui ne se termine que par une confusion théorique.
Cependant, il y a eu de nombreuses exceptions à cette règle en Occident, surtout parmi les mystiques, qui ont insisté tout aussi fortement que leurs homologues orientaux sur la nécessité de l’expérience directe, et sur l’inefficacité des symboles et des processus discursifs ordinaires de l’esprit. Saint Jean de la Croix le dit catégoriquement : « Tout ce que l’imagination peut imaginer et la raison concevoir et comprendre dans cette vie n’est pas et ne peut pas être, un moyen approximatif d’union avec Dieu ». Et la même idée est exprimée par le grand mystique anglican du XVIIIe siècle, William Law, qui dit : « Trouver ou connaître Dieu en réalité par des preuves extérieures, ou par quoi que ce soit d’autre que Dieu lui-même rendu manifeste et évident en vous, ne sera jamais votre cas, ni ici ni dans l’au-delà. Car ni Dieu, ni le ciel, ni l’enfer, ni le diable, ni la chair, ne peuvent être connus en vous ou par vous autrement que par leur propre existence et manifestation intérieure. Et toute prétendue connaissance de l’une de ces choses, au-delà et sans cette sensibilité évidente de leur naissance en vous, n’est qu’une connaissance de ces choses, comme celle que l’aveugle a de la lumière qui n’est jamais entrée en lui ». Ceci, comme je le dis, est l’équivalent occidental de cette répétition constante que l’on retrouve dans toute la littérature orientale.
Très brièvement, parlons de ce qu’est l’expérience mystique. Je suppose que l’expérience mystique consiste essentiellement à être conscient et, tant que l’expérience dure, à être identifié à une forme de conscience pure – de conscience non structurée, transpersonnelle, se situant, pour ainsi dire, en amont de la conscience discursive ordinaire de tous les jours. C’est une conscience non égoïste, une sorte de conscience informe et intemporelle, qui semble sous-tendre la conscience de l’ego séparé dans le temps.
Maintenant, pourquoi ce genre de conscience devrait-elle être considérée comme précieuse ? Pour deux raisons, je pense : Tout d’abord, elle est considérée comme précieuse en raison de la sensibilité évidente de la valeur, comme dirait William Law. Elle est considérée comme intrinsèquement précieuse, tout comme esthétiquement l’expérience de la beauté est considérée comme précieuse. C’est comme l’expérience de la beauté, mais beaucoup plus, pour ainsi dire. Et elle a une valeur, secondairement, parce qu’en tant qu’expérience empirique, elle entraîne des changements dans la pensée, le caractère et le sentiment que l’expérimentateur et son entourage considèrent comme manifestement désirables. Elle rend possible un sentiment d’unité, de solidarité, avec le monde. Elle rend possible une sorte d’amour et de compassion universels, cette sorte d’amour et de compassion sincère qui est tant soulignée dans l’Évangile, où le Christ dit : « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés ». Et il y a une phrase qui a été utilisée par Sainte Catherine de Sienne sur son lit de mort, qui souligne à nouveau ce point avec une extrême importance, où elle a dit avec beaucoup de force : « Il n’y a aucune raison de juger les actions des créatures ou leurs motifs. Même lorsque nous voyons qu’il s’agit d’un péché réel, nous ne devons pas le juger, mais avoir une compassion sainte et sincère et l’offrir à Dieu avec une prière humble et dévote ». Le mystique, je pense, est rendu capable de ce genre d’amour, et est capable de comprendre organiquement des phrases aussi pompeuses qui semblent extrêmement difficiles à comprendre pour une personne ordinaire – je veux dire des phrases comme « Dieu est Amour » ou « Bien qu’il me tue, je me fierai à Lui ». Ces phrases deviennent compréhensibles pour une personne qui a vécu ce genre d’expérience. Il y a certainement un dépassement de la peur de la mort, une conviction que l’âme est devenue identique à une sorte de principe absolu qui s’exprime à chaque instant dans sa totalité. Il y a une acceptation de la souffrance en soi, et un désir passionné d’alléger la souffrance des autres. Il y a, en un mot, une combinaison de ce que les bouddhistes appellent prajna paramita, qui est la sagesse de l’autre rive, avec maha karuna, qui est la compassion universelle. Comme le dit Eckhart, « Ce qui est pris dans la contemplation est donné dans l’Amour ». Et c’est, comme je le dis, la valeur de l’expérience.
Quant à la théologie de l’expérience – lorsqu’il est jugé nécessaire d’en faire une théologie – elle est profondément simple et se résume aux trois mots qui sont à la base de la quasi-totalité de la religion et de la philosophie indiennes : « Tat tvam asi » (« tu es Cela »), dans le sens où la partie la plus profonde de l’âme est identique à la nature divine – que l’Atman, le Soi profond, est le même que Brahman, le principe universel. Ou, selon les termes d’Eckhart, que le fondement de l’âme est identique au fondement de la divinité. Et cette idée a bien sûr été exprimée sous de nombreuses formes, notamment l’idée de la Lumière Intérieure, l’Étincelle de l’Âme.
Maintenant, très brièvement, je dois juste évoquer les moyens d’atteindre cet État. Là encore, il a été constamment souligné que les moyens ne consistent pas en une activité mentale et un raisonnement discursif. Ils consistent en ce que Roger Fry, parlant de l’art, appelait « passivité alerte », ou en ce qu’un mystique américain moderne, Frank C. Laubach, a appelé « sensibilité déterminée ». C’est une phrase très remarquable. Vous ne faites rien, mais vous êtes déterminé à être sensible pour laisser quelque chose se faire en vous. Et c’est ce qu’ont exprimé certains des grands maîtres de la vie spirituelle en Occident.
Saint François de Sales, par exemple, écrit à son élève, Sainte Jeanne de Chantal : « Vous me dites que vous ne faites rien dans la prière. Mais que voulez-vous faire dans la prière, à part ce que vous faites, c’est-à-dire présenter et représenter votre néant et votre misère à Dieu ? Lorsque les mendiants exposent leurs ulcères et leurs besoins à notre vue, c’est le meilleur appel qu’ils puissent faire. Mais d’après ce que vous me dites, il arrive que vous ne fassiez rien de tout cela, mais que vous restiez allongé comme une ombre ou une statue. Ils mettent des statues dans les palais simplement pour plaire aux yeux du prince. Contentez-vous d’être cela en présence de Dieu : il donnera vie à la statue quand il le voudra ».
Les paroles de Sainte Jeanne confirment sa compréhension des conseils de De Sales.
« J’en suis venu à constater que je ne limite pas mon esprit assez simplement à la prière, que je veux toujours y faire quelque chose moi-même, dans lequel je fais très mal… Je veux absolument couper et séparer mon esprit de tout cela, et le maintenir de toutes mes forces, autant que je le peux, au seul regard et à la simple unité. En laissant la peur d’être inefficace entrer dans l’état de prière, et en souhaitant accomplir quelque chose moi-même, j’ai tout gâché ».
Cette attitude des maîtres de la prière est, en dernière analyse, exactement la même que celle adoptée par l’enseignant de n’importe quelle compétence psychophysique. L’homme qui vous apprend à jouer au golf ou au tennis, ou un professeur de chant, un professeur de piano, vous dira toujours la même chose : vous devez d’une manière ou d’une autre combiner activité et détente. Vous devez lâcher prise de ce moi personnel qui vous serre afin de laisser ce Moi, plus profond en vous, se manifester et accomplir – on peut dire – ses miracles, que vous entravez. Et, dans un certain sens, on peut dire que ce que nous faisons tout le temps, c’est d’entrer dans notre propre lumière. Nous éclipsons notre Soi profond par notre moi superficiel, et ne permettons donc pas à cette force vitale, cette lumière (quel que soit le nom que vous lui donnez), qui est – comme nous le découvrons au fur et à mesure que nous lâchons prise – un fait empirique en nous, de se manifester. En fait, l’ensemble de la technique de compétence dans tous les domaines, y compris cette forme la plus élevée de compétence spirituelle, est un processus de déconnexion, un processus qui consiste à sortir de notre propre lumière et à permettre à cette chose de se manifester.
Et bien sûr, si quelqu’un ne veut pas formuler ce processus en termes théologiques, il n’a pas à le faire ; il est possible de le penser strictement en termes psychologiques. Il se trouve que je crois moi-même que ce Soi profond qui est en nous est en quelque sorte en continuité avec l’Esprit de l’univers, ou quel que soit le nom qu’on lui donne ; mais il n’est pas nécessaire de l’accepter. Vous pouvez pratiquer cela entièrement en termes psychologiques et sur la base d’un agnosticisme complet par rapport aux idées conceptuelles de l’orthodoxie religieuse. Un agnostique peut pratiquer ces choses et pourtant arriver à la gnose, à la connaissance ; et les fruits de la connaissance seront les fruits de l’Esprit : l’amour, la joie et la paix, et la capacité d’aider les autres. Comme nous le voyons, il n’y a pas vraiment de conflit entre l’approche mystique de la religion et l’approche scientifique, simplement parce qu’on ne s’engage pas dans une déclaration tranchée et sèche sur la structure de l’univers. On peut rester complètement agnostique par rapport aux conceptualisations orthodoxes de la religion et pourtant, comme je le dis, arriver à la gnose et, enfin, exhiber les fruits de l’Esprit. Et, comme le Christ l’a dit dans l’Évangile : « L’arbre sera connu par ses fruits ».